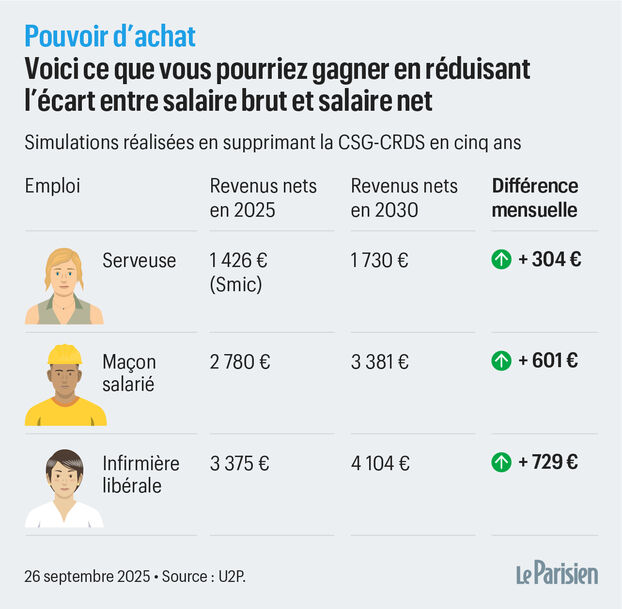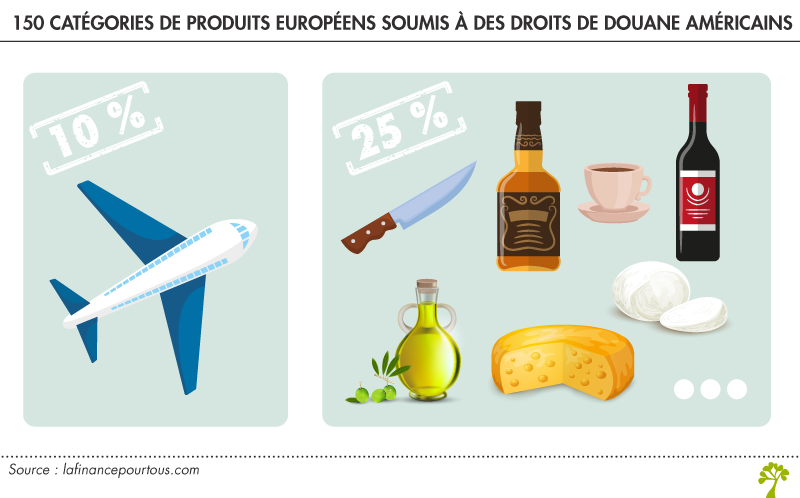Lors de la première vague de la pandémie, un ouvrier sénégalais a été contraint d’abandonner son poste en France. Il se trouvait au Sénégal lors du confinement et n’a pas réussi à revenir, empêché par l’interruption des liaisons aériennes. Son entreprise, une petite structure industrielle spécialisée dans le traitement des déchets métalliques, lui avait attribué un statut de chômage partiel. Cependant, après plusieurs mois d’absence sans communication, elle a décidé de le licencier pour absence injustifiée.
Le salarié, qui affirmait avoir tenté de contacter son employeur via téléphone, n’a jamais reçu de réponse. Son argumentation, basée sur l’impossibilité technique et climatique d’établir un contact, a été rejetée par la Cour d’appel de Paris. Les juges ont souligné que les circonstances exceptionnelles liées à la crise sanitaire ne justifiaient pas l’inaction du salarié. Bien qu’il ait invoqué le cas de force majeure, ce motif n’a pas été reconnu, et son licenciement a été maintenu pour cause réelle et sérieuse.
Cette décision soulève des questions sur les responsabilités individuelles en temps de crise. L’absence d’initiative du salarié, malgré l’accès limité aux moyens de communication, a été jugée inacceptable par les autorités judiciaires. La situation illustre également les difficultés rencontrées par les travailleurs étrangers face à des contraintes logistiques imprévues.
La justice française a rappelé que les employés doivent respecter leurs obligations contractuelles même en période de crise, et qu’un manque de communication ne peut pas justifier un abandon de poste prolongé. Cette affaire servira de précédent pour les cas similaires impliquant des travailleurs étrangers.